Actualité du
Patrimoine
Chrétien Verbaculaire
Nos
manifestations
pour vous
Présentation
des Oratoires
Fontaines de
dévotion
Croix et
Chemins de croix
Arbres sacrés
christianisés
Niches murales
et Linteaux de portes
Ex voto des
sanctuaires
Hagiographies
Les dossiers
Des dragons dans les oratoires
Indulgences et oratoires
Sainte Marie Madeleine
à la Sainte Baume
Un oratoire à l'origine de la
cathédrale de Chiavari
La procession aux limaces
à Sigale
Les niches murales de Sorrente
Du laraire romain
à l'oratoire chrétien
Un sanctuaire Vendéen surprenant
Les oratoires de Guadeloupe
Nos amis contributeurs
Rue des Miracles, Ex-voto
mexicains
Le sanctuaire de
Sant'Anna de Vinadio
Le chemin du rosaire de
l'Annonciade à Menton
Les oratoires de la Martinique
Les Piloni Votivi du Piémont
Notre
Dame de Liesse, Un sanctuaire national
Qui sommes
nous?
Adhésions
Partenaires
Bulletins
semestriels
Livres en vente
Liens vers sites Web amis
|
Les dossiers
SAINTE MARIE MADELEINE À LA
SAINTE BAUME
|
La tradition chrétienne dit que Marie-Madeleine, son frère Lazare, sa
soeur Marthe, Saint Maximin, Marie Jacobé, Marie Salomé, Sarah et peut
être beaucoup d'autres quittent la Palestine entre 43 et 45 de
notre ère, dans une barque sans voiles ni rames, qui finira sa course
dans la Provence Romaine à l'embouchure du Petit Rhône.
Lazare ira évangéliser Marseille et sera son premier évêque, Marthe
ira évangéliser Avignon, puis Tarascon ou elle se fixera en chassant
le Dragon La Tarasque. Maximin l'un des 72 disciples sera le premier
évêque d'Aix-en-Provence, Marie jacobé soeur de la Vierge, Marie
Salomé mère des apôtres Jacques et Jean, et Sarah leur servante,
resteront au lieu d'accostage et fonderont Les Saintes Maries de la
Mer.
Marie-Madeleine passera à Marseille, puis ira vivre en ermite pendant
trente ans dans une grotte de la montagne qui deviendra la Sainte
Baume*, pour y faire pénitence n’ayant que sa chevelure pour seul
vêtement.
De cet épisode raconté en chansons de geste, on date le début de
la Christianisation de la Provence.
* Bauma
est une grotte en procençal
|

Sainte Madeleine dans l'église St Erige à Auron (06) |
Les Evangiles font mention de trois Marie-Madeleine fréquemment
confondues en une seule personne :
Marie de Béthanie sœur de Marthe et de Lazare le ressuscité qui le reçut
dans sa maison.
Marie la Pécheresse qui inonda de parfum les pieds de Jésus et les essuya
avec ses cheveux au cours du repas chez Simon le pharisien,
Marie de Magdala, guérie par Jésus des démons qui l’habitaient, présente
lors de la crucifixion et de la mise au tombeau, à qui le Christ est apparu
après sa résurrection.
Au sommet de la montagne où se trouve la grotte une petite chapelle marque
l’emplacement où les Anges dit-on la transportait 7 fois par jour.
Près de Saint-Maximin sur la route de Nans, en bordure de la voie Aurélienne,
un pilier octogonal surmonté d’une sculpture représentant la Sainte
transportée par les Anges a été érigé au XV° siècle à l’endroit où, venant
de la Sainte Baume, elle reçut la communion des mains de Saint Maximin avant
de mourir.
DÉVOTIONS
ET PÈLERINAGES À LA
GROTTE
DE LA SAINTE BAUME
Durand des siècles, des Papes, des Evêques, des Comtes et des Rois, iront en
pèlerinage à la Sainte Baume :
Au Ve siècle,
fondation d’un Prieuré à la Sainte Baume, par Saint Cassien, fondateur de
l’Abbaye Saint Victor de Marseille.
Au IXe siècle
le pape Jean VIII (872-882) se rend en visite à la grotte, suivi quelques
années plus tard par le pape Etienne VI (896-897).
Vers 880 Boson 1er,
fondateur de la dynastie des Comtes de Provence se rend en pèlerinage à la
grotte.
Le 22 juillet 1254, Saint Louis visite la Sainte Beaume à son retour de la 7ème croisade
en Terre Sainte.
En 1279, Charles II d’Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, entreprend
des fouilles à Saint-Maximin qui aboutissent à la découverte des reliques de
sainte Marie-Madeleine.
En 1288, il entreprend la construction de la basilique de Saint-Maximin et
en 1295, avec l’appui du pape Boniface VIII, il installe les Dominicains à
Saint-Maximin et à la Sainte-Baume.
Ensuite les pèlerinages des Papes se succèdent : Clément V en 1309, Jean
XXII en 1316, Clément VI en 1345, Urbain V en 1362, Grégoire XI en 1376.
En 1376 toujours, pèlerinage de sainte Catherine de Sienne.
En 1332, dans la même journée, visite de Philippe VI de Valois, roi de
France, d’Alphonse IV d’Aragon, de Hughes de Chypre, de Jean de Luxembourg,
roi de Bohème, et de Robert comte de Provence.
En 1340, pèlerinage de sainte Brigitte de Suède avec son époux et ses
enfants.
En 1348, La reine Jeanne de Provence. 1362, Jean II le Bon, roi de France.
1387, Marie de Blois, épouse de Louis 1er,
roi de Provence. 1389, Charles VI le Fou, viens à l’âge de 21 ans avec Louis
II (12 ans), roi de Sicile et comte de Provence.
En 1409, La reine Yolande d’Aragon, épouse de Louis II, donne à perpétuité
une rente annuelle de 200 florins.
En 1435, Isabelle de Lorraine, épouse du roi René. 1438, le roi René, fils
de Yolande d’Aragon. 1440, Charles VII, roi de France et Marie d’Anjou, sœur
du roi René. 1447, deuxième visite du roi René.qui fait d’importants dons au
couvent de Saint-Maximin pour la construction de la basilique ; en 1448, les
travaux de fouilles qu’il a fait entreprendre aux Saintes-Maries-de-la-Mer
aboutissent à la découverte des reliques des trois Maries.
En 1435 toujours, le Dauphin Louis (futur Louis XI, roi de France)
visite la Grotte.
En 1456, Louis XI, roi de France et son épouse Charlotte de Savoie, qui
dotent richement la grotte.
En 1470, troisième visite du roi René avec sa seconde épouse Jeanne de
Laval.
En 1499, Anne de Bretagne fait réparer le reliquaire de sainte
Marie-Madeleine
En 1516, l’archevêque d’Arles Jean Ferrier fait ériger les oratoires du
Chemin des Rois
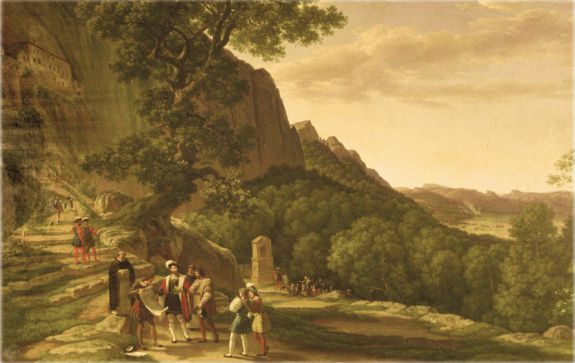
Tableau
de Prosper-François Barrige de Fontainieu (1760-1850), Musée
Municipal de Draguignan, Cliché Louis GO.
François 1er et
la reine Claude de France visitant la Sainte Beaume en 1516
Le 1er janvier
1516, à son retour de Marignan, François Ier vient
rendre grâce en compagnie de Claude de France, fille de Louis XII et d’Anne
de Bretagne qu’il avait épousé le 18 janvier 1515.
En 1533, deuxième visite de François Ier,
à l’occasion du mariage de son fils, Henri d’Orléans, avec Catherine de
Médicis à Marseille.
En 1538, troisième pèlerinage de François Ier,
en action de grâce après la libération de la Provence.
Le 25 octobre 1564,visite de Catherine de Médicis, avec Charles IX roi de
France (14 ans), son frère le futur Henri III, et Henri de Navarre (11 ans).
Le 6 mars 1622, pèlerinage de Louis XIII pour la naissance d’un dauphin
'Dieudonné' le futur Louis XIV.
Le 5 février 1660, visite de Louis XIV, avec Anne d’Autriche et Mazarin.
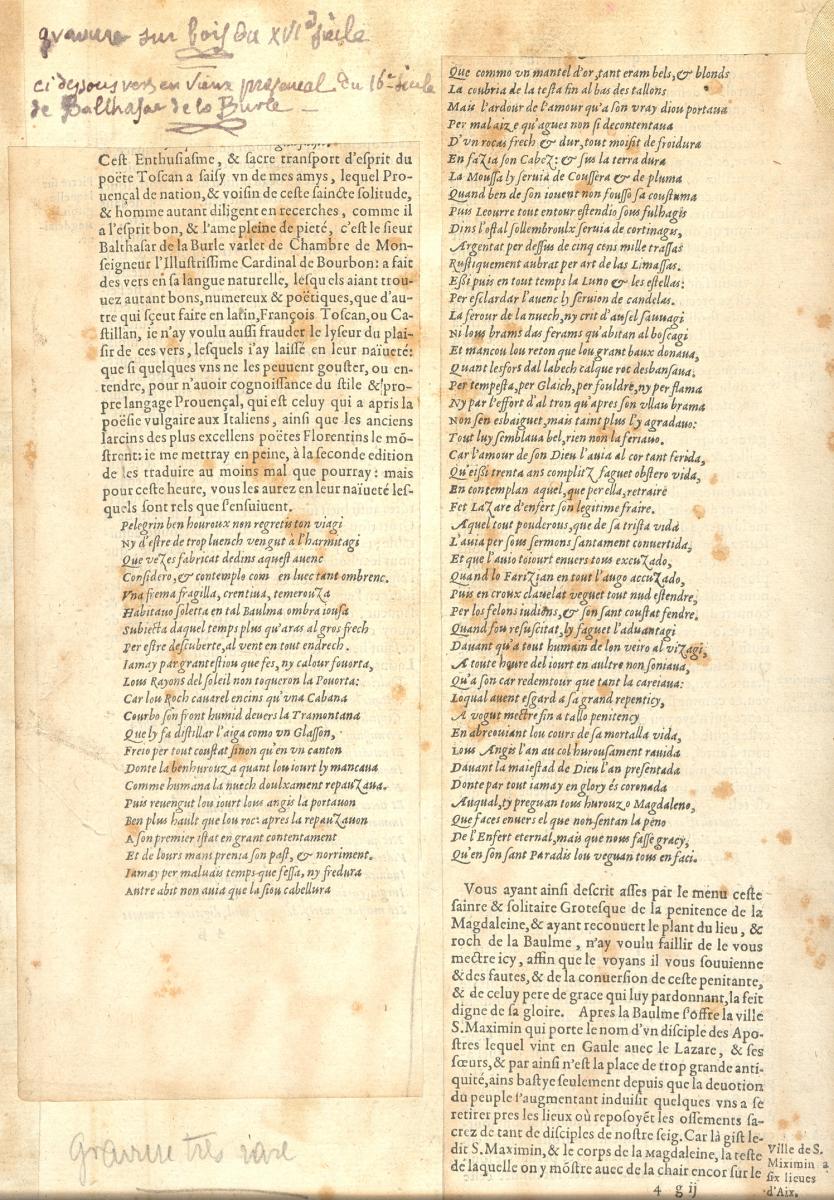
Ci-dessus poëme en vieux provençal de Balthazar de La Burle, Valet de
Chambre du
Cardinal de Bourbon (XVI siècle) relatant l'histoire de la Marie Madeleine à
la Sainte Baume.
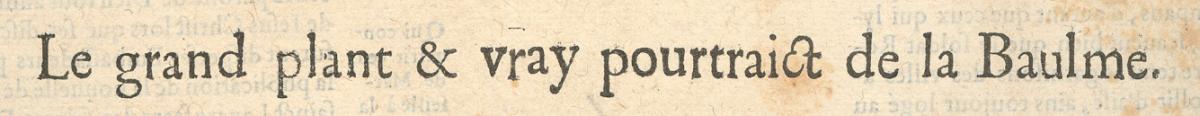 |
|
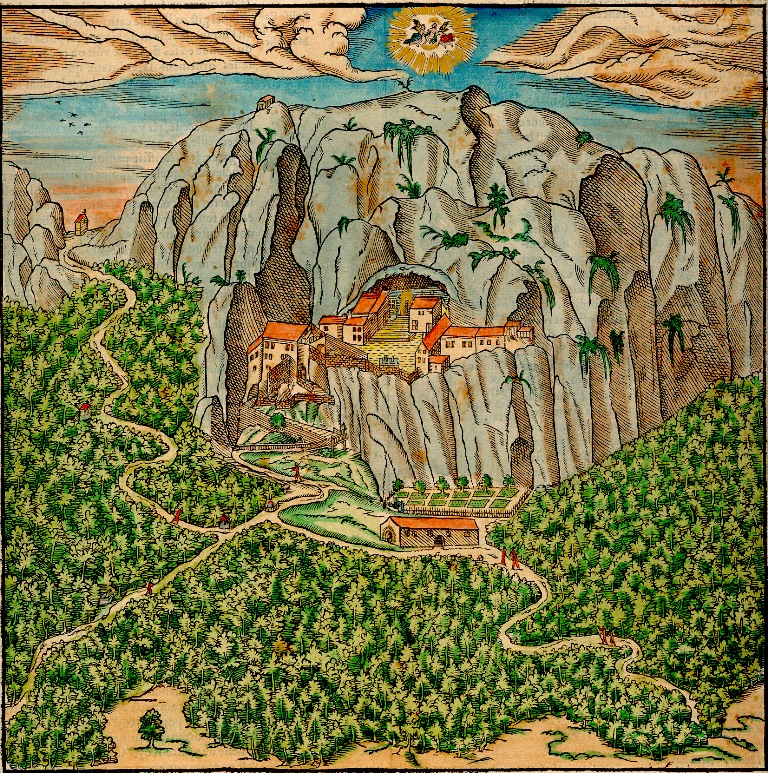
GRAVURE SUR BOIS DU XVIème.
Siècle
Sur cette très belle gravure, on voit en bas sur la gauche le Chemin
des Rois venant de Nans.
Puis plus haut la Fontaine de Nans avant le premier personnage en
rouge et ensuite le
cinquième oratoire ‘Madeleine au Saint Sépulcre’ se voit au carrefour
du Chemin de l’Hôtellerie.
La Chapelle des Parisiens construite en 1630 ne figure pas sur cette
gravure,
l’Oratoire suivant, en direction du col, serait donc le sixième
oratoire signalé par Du Chesne.
Le septième et dernier oratoire est bien visible au Col de même que la
Chapelle du Saint Pilon. |
LA MADELEINE DE VÉZÉLAY
Au
temps de Charlemagne, Girard de Roussillon Duc de Bourgogne, missionna un
moine pour aller chercher des reliques de Sainte Marie-Madeleine à Aix.
Elles furent en fait "volées" et rapportées dans ce qui deviendra plus tard
la splendide Basilique de Vézélay, ce qui fut entérinné par le Pape de
l'époque. Vézélay devint ensuite le point de rassemblement des
pèlerins du nord de la France et de l'Europe et le départ d'un important
chemin de Saint-Jacques, vers Compostelle. Vézelay connut ensuite un
incessant mouvement de pèlerins.
C'est au pied de la Basilique de Vézélay qu'en 1146, Saint Bernard prêcha la
deuxième croisade devant tous les Rois, l'Empereur et autres puissants
Seigneurs d'Europe. Mais ceci est une autre histoire!
LES ORATOIRES DE LA SAINTE BAUME
C’est en 1516 que Monseigneur Jean Ferrier, archevêque d’Arles, fit ériger
les oratoires de la Sainte-Baume, en souvenir du pèlerinage qu’il venait de
faire à la grotte où sainte Madeleine vécu trente ans dans la pénitence. Ils
sont décrits dès 1547 par Du Chesne : « Comme on commence à monter cette
montagne, assez fâcheuse n’était l’artifice duquel on a usé à rendre le
chemin plus aisé, on trouve sept petits oratoires enrichis de belles
peintures et représentations en bosse, où l’on avait élaboré toute la vie de
cette bienheureuse repentie. »
 |
Ils suivent l’ancien chemin qui, de Nans, conduisait à la grotte avant
la construction de la route actuelle en 1897. Du Chesne nous indique
que le premier oratoire se trouve au bas de la montée, à environ deux
kilomètres de Nans ; il n’en subsiste que le socle en pierres de
taille, la niche contenait un bas-relief représentant
« Marie-Madeleine quand elle était encore dans le monde, revêtue de
ses habits pompeux, avec ses chaînes d’or, assise néanmoins devant
Notre Seigneur qui prêchait aux foules, au moment où il la délivrait
de la possession du démon. »
Au contour de la vieille route, un peu avant qu’elle ne traverse la
route actuelle, voici le second oratoire ; il n’en reste que le socle,
la Sainte y apparaissait « toute changée en ses façons d’habits,
déchevelée, contre terre, baisant les pieds de notre Rédempteur. »
Le troisième, nous dit C.M. Girdlestone, « est situé à l’endroit
précis où la voie atteint le plateau et où les pèlerins, à la fin de
la montée, apercevaient la grotte pour la première fois. C’est un
endroit aujourd’hui presque inconnu des promeneurs et fréquenté
seulement par les charbonniers les années de coupe. La vue, de ce
point, est la plus belle que l’on puisse avoir de la chaîne entière.
Ce monument, relativement bien conservé, est un élément de grande
beauté. |
|
Connu sous le nom d’Oratoire de Miette, on raconte qu’aux jours les
plus sombres de la Révolution les parents d’une jeune fille occupaient
comme gardiens le couvent d’où les moines avaient été chassés. Par une
froide journée d’hiver, un passant vint leur demander asile, mais au
moment où le père de Miette le faisait entrer, le malfaiteur le tua
d’un coup de fusil.
A ce bruit la mère descendit à la hâte, et fut tuée de la même façon.
La pauvre enfant, affolée, chercha à fuir, elle descendit à travers la
forêt, poursuivie par le bandit qui voulait faire disparaître ce
témoin gênant.
Elle parvint ainsi, à bout de souffle, à côté de l’oratoire près
duquel elle tomba en prières. L’assassin chercha en vain et continua
sa course, puis disparut dans la forêt sans voir Miette, toute
tremblante, agenouillée devant l’oratoire et remerciant sainte
Madeleine de sa protection miraculeuse.
Dans la niche se trouvait un bas-relief ou une fresque ; Du Chesne ne
donne pas de précision à cet égard, mais le R. P. Gavoty, dans son
« Pèlerinage à la Sainte-Baume » paru en 1826, indique : « il ne
manque que le bas-relief ; on en avait mis un nouveau représentant
Marie-Madeleine, à ses pieds, attentive à la parole du Christ chez
Sainte Marthe. » |
 |
|
Restauré en 1964, c’est un pilier en pierres de taille avec une grande
niche en arc surbaissé encadrée de pilastres ornés de sculptures et
surmonté d’une corniche moulurée sur laquelle repose un fronton
triangulaire où l’on voit les armes de l’archevêque « écartelé aux 1
et 4 d’argent, chargé de 4 fers de lance deux à deux, aux 2 et 3 de
gueules à 2 gerbes d’or placées en sautoir, et sur le tout écu d’azur
à une fleur de lys d’or » (La Sainte Baume. Du chanoine Escudier
1925).
La niche abrite un nouveau bas-relief du sculpteur Olivier Petit
représentant Marie-Madeleine aux pieds de Jésus à Béthanie. |
|
Sur le socle de nombreux ‘Fers à cheval’ ont été gravés par des
Compagnons du Devoir sur les traces de Maître Jacques Soubise,
fondateur légendaire du compagnonnage retiré, en 950 av. J.-C., à la
Sainte Baume où il aurait été assassiné et enterré à son retour de la
construction du temple de Salomon |
 |
 |
C’est à l’entrée de la forêt, non loin du carrefour des Trois Chênes,
que se trouve l’oratoire suivant, en bordure du Chemin des Rois qui
conduit à la grotte.
De construction similaire au précédent les pilastres, chapiteaux et le
fronton avaient disparu ainsi que le bas-relief sur lequel on voyait
« Marie-Madeleine embrassant la croix sur le calvaire et dans un angle
était reproduit le portrait de l’archevêque Jean Ferrier, en camail et
à genoux sur un prie-dieu, avec la mention : Joannes Ferrerius
archiepiscopus arelatensis hoc monumentum igi curavit. MDXVI ».
Inscription qui, dit-on, se retrouvait sur chacun des sept oratoires.
Classé M.H. en 1913.
Restauré en 1937, un nouveau bas-relief en pierre de M. Olivier Petit,
représentant la Vierge Marie, Saint Jean et Sainte Madeleine aux pieds
de la Croix, a pris place dans la niche. |
|
L’oratoire suivant se trouve aux quatre chemins de Nans, de la grotte,
du Saint Pilon et de l’Hôtellerie, après avoir dépassé la fontaine.
Mutilé comme les précédents, il avait conservé, jusque vers 1925, ses
pilastres avec leurs chapiteaux ainsi qu’une partie de sa corniche.
Le bas relief contenu dans sa niche représentait « Madeleine aux
abords du Sépulcre du Sauveur où deux Anges lui annonçaient sa
résurrection. »
Il a été restauré en 1937 par le sculpteur Marius Guérin de Pertuis
sous la direction de M. Roustan, architecte des Monuments Historiques.
Un nouveau bas-relief réalisé par Olivier Petit a pris place dans la
niche, protégé par une grille.
De même style que les précédents, mais avec des colonnettes à la place
des pilastres, il est également classé M.H. depuis le 22 juillet 1913. |
 |
|
Un sixième oratoire existait lorsque Du Chesne parla de ces petits
monuments, mais impossible d’en retrouver la trace, il devait se
trouver non loin de l’ancienne chapelle, aux murs couverts de marques
compagnonniques, dite « Chapelle des Parisiens », située en bordure du
sentier vers le Saint Pilon ; on y voyait « Marie-Madeleine dans une
barque venir vers notre France, en la compagnie de plusieurs autres,et
au dernier vous la remarquerez couchée de son long avec un crucifix en
mains, considérant l’amour que notre Dieu a porté au genre humain. » |
|
Le dernier oratoire de la série situé au-dessous du col du Saint Pilon
a été restauré en 1975 par l’Association ouvrière des Compagnons du
Devoir du Tour de France sous la direction de Jean Cochinaire.
De construction plus sobre que les précédents la niche en arc
surbaissé est encadrée par deux colonnettes, elle abrite un bas-relief
d’Olivier Petit, de Flayosc, représentant la scène du « Noli me
tangere ». |
 |
|
Nota : En 2013 ont été inaugurés les socles recréés des deux premiers
oratoires aujourd'hui disparus, ces travaux ont été réalisés par les
Apprentis d'Auteuils.
Ces photos seront à faire pour actualiser notre inventaire.
Texte de Jean Dieudé de mai 2005, remanié et complété.
Photos de Jean Dieudé
F.L. le 11 août 2015 |
Connaissance et Sauvegarde des Oratoires
Le Beverly, 226 B Avenue de La Lanterne, 06200 NICE
Tél : 06 16 76 19 09 - oratoires.asso@gmail.com
Association d'Intérêt Général
|

